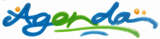Blada.com
mardi 03 février
Boîtes aux lettres
Courrier des lecteurs
Petites annonces
Emploi / Formation
Covoiturage
Infos citoyennes
Infos citoyennes
21/07/25
Vingt-six étudiants admis en deuxième année de médecine
Les résultats du rattrapage sont tombés pour les étudiants en première année de médecine. Ils sont vingt-six à passer en deuxième année, qu’ils pourront effectuer en Guyane. Le Pr Pierre Couppié, doyen de l’UFR santé, explique ce que la création de cette unité, ainsi que celle du CHU, changent pour la formation en Guyane.

Les résultats des rattrapages sont tombés la semaine dernière et les choix des affectations ont été annoncés cette semaine, pour les 140 étudiants de première année de médecine, en Guyane. Depuis dix ans que la première année existe en Guyane, jamais autant d’étudiants sont passés en deuxième année. Ils seront donc :
- 26 à rentrer en deuxième année de médecine, en septembre, année qu’ils effectueront en Guyane, comme la troisième ;
- 2 à rejoindre la filière dentaire, à Nantes ;
- 2 à partir en deuxième année de pharmacie, à Bordeaux ;
- 4 à poursuivre à l’école de sages-femmes, à Fort-de-France ;
- 1 à continuer en masso-kinésithérapie, à Fort-de-France également.
Par ailleurs :
- Les 19 étudiants de deuxième année passent en troisième année ;
- Dix-huit des 19 étudiants de troisième année passent en quatrième année.
Pr Pierre Couppié : « Avant la création des deuxième et troisième années de médecine, un étudiant passait au moins neuf ans hors du territoire »
 Début mai, vous avez participé à un congrès sur l’universitarisation de la santé aux Antilles-Guyane. Quels enseignements en avez-vous tirés ?
Début mai, vous avez participé à un congrès sur l’universitarisation de la santé aux Antilles-Guyane. Quels enseignements en avez-vous tirés ?
S’il y a un mot qui est ressorti, dont les politiques nous ont rappelé qu’il n’est pas dans le dictionnaire, c’est « universitarisation ». C’était intéressant que des politiques nous disent qu’ils ne connaissaient pas ce mot-là. Le grand intérêt de l’universitarisation de la santé et de la Guyane, c’est le développement : développement de la santé, développement de l’hôpital, de l’enseignement et de la recherche.
Quels points communs ou différences avez-vous constatés entre les trois territoires ?
Ce qu’il y a de commun, c’est le besoin de développer la santé d’un point de vue universitaire : recherche et formation en plus du soin. Pour qu’il y ait de la qualité, les trois doivent aller ensemble. Il y a aussi le problème de désert médical, que nous avons en Guyane et que les Antilles ont à un degré moindre. Mais chez eux, cela se passe dans un contexte de vieillissement de la population. Les Antilles ont déjà un niveau de développement plus ancien du fait d’une population plus importante depuis plus longtemps. Chez nous, le développement est plus récent. Enfin, si l’on prend l’ensemble Antilles-Guyane, le déficit d’universitaires est plus important par rapport à la Métropole.
Et s’agissant des différences ?
La Guyane est isolée. Le CHU le plus proche se situe à 1 400 kilomètres. Nous sommes le territoire le plus éloigné d’un autre CHU. D’autres régions de l’Hexagone ont des déserts médicaux. C’est le cas en Normandie mais il y a deux CHU dans la région, à Caen et à Rouen. Enfin, la géographie de la Guyane est particulière. Avec Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, nous avons un CHU qui fait 300 km de long. Et davantage si on ajoute les centres de santé. Ce n’est pas le cas aux Antilles.
Quel regard ont porté les doyens de l’Hexagone, présents à ce congrès ?
Ils voient bien qu’en Guyane, nous sommes à la pointe dans les maladies tropicales et en santé publique. Les doyens de l’Hexagone rêvent tous d’envoyer leurs internes effectuer un semestre dans nos services. Nous en recevons, d’ailleurs. C’est un plus pour la Guyane.
Face à ce désert médical, comment recruter davantage de médecins ?
Aujourd’hui, il y a trois façons de recruter des médecins :
- Que les lycéens guyanais aient la possibilité de débuter leurs études de médecine sur place. Ce levier n’était guère efficace jusqu’à présent puisqu’il n’y avait que la première année. Au départ, nos étudiants étaient classés avec les Antilles et très peu passaient en deuxième année. Depuis dix ans, avec la création de l’Université de Guyane, nous avons un numerus clausus, devenu numerus apertus, propre à la Guyane. Nous sommes passés de deux étudiants qui passaient en deuxième année de médecine à une vingtaine aujourd’hui. En créant la deuxième et la troisième années de médecine, nous créons les conditions pour revenir exercer en Guyane. Un jeune Guyanais qui partait dès la deuxième année à l’extérieur, passait au minimum neuf ans à l’extérieur du territoire, onze s’il voulait devenir chirurgien. Il y avait donc un risque important de non-retour au pays. Ces deuxième et troisième années permettent d’avoir des étudiants qui effectuent des stages ici et ont passé davantage de temps en Guyane.
- Le deuxième levier, ce sont les internes. Un interne qui a passé du temps sur le territoire est davantage disposé à s’y installer. Le fait d’avoir des services attractifs permet aux étudiants de faire leur internat aux Antilles-Guyane ou de venir en interCHU.
- Le troisième levier, ce sont les médecins seniors. Il aura plus de chance de venir s’il vient dans un service où il y a déjà une équipe constituée, avec des internes, des assistants… Avoir des services universitaires crée cet écosystème favorable à la venue de médecins seniors. Enfin, il y a la recherche qui permet d’être toujours au top des connaissances et d’adapter les soins, les méthodes diagnostiques…
Que change l’UFR en matière de recrutement ?
Avoir un CHU et une UFR permet de créer directement des postes hospitalo-universitaires en Guyane : PU-PH, MCU-PH et chefs de clinique ou assistant universitaire. Actuellement, tous les universitaires sont recrutés aux Antilles et mis à disposition de la Guyane. Le CHU et l’UFR rendent les choses plus simples.
Quelles sont les perspectives de création de postes hospitalo-universitaires ?
Nous pouvons entamer nous-mêmes les négociations (pour les créations de postes). Lorsque nous avons créé le DFR santé, en 2015, dans le cadre de la création de l’Université de Guyane, il y avait trois PU-PH à l’hôpital de Cayenne : Nathalie Demar, Mathieu Nacher et moi, plus un chef de clinique. Nous couvrions la dermatologie, la santé publique et la parasitologie. Aujourd’hui, nous sommes treize PU-PH, deux MCU-PH et cinq chefs de clinique. C’est ça aussi qui a permis de dire que nous étions prêts pour créer le CHU. Lorsque La Réunion a créé le sien, elle avait trois PU-PH.
Quels sont les objectifs pour l’avenir ?
Continuer d’augmenter les effectifs hospitalo-universitaires. Il y a deux moyens :
- Dans l’idéal, universitariser des spécialités prioritaires : la cardiologie en nommant le Pr Inamo en Guyane, la psychiatrie… Mais s’il n’y a pas de candidat, ça ne va pas plus loin.
- L’autre possibilité, c’est de regarder qui l’on a comme candidats et dans quelles spécialités. On repère des professionnels.
Y en a-t-il beaucoup ?
Nous avons une liste d’une dizaine de praticiens. Dans les années à venir, ils pourront réaliser le travail pour devenir hospitalo-universitaires.
Comment cela se passe-t-il ?
Depuis quelques années, nous développons la possibilité, pour des praticiens qui font déjà de la recherche, de bénéficier des conditions pour devenir hospitalo-universitaire. Nous avons développé les séminaires d’écriture scientifique et de statistiques avec le Pr Mathieu Nacher, et créé les postes accueil recherche. C’est un incubateur, une pépinière, une pouponnière d’hospitalo-universitaires. Quand des doyens ou le directeur de l’Inserm nous rendent visite, ils sont très surpris et nous envient cette façon de faire. Tout cela est soutenu par une recherche en santé qui est de bon niveau. Le HCeres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) souligne depuis longtemps l’excellence de la recherche en Guyane. Nous sommes dans un cycle vertueux. La recherche améliore la formation qui améliore la clinique qui booste la recherche. Cette dynamique a permis de créer le CHU et le CHU va renforcer cette dynamique. Le leitmotiv, c’est d’être utile à la population. L’universitarisation permet d’augmenter le nombre de soignants et d’augmenter leur qualité.
Comment se sont passés les ouvertures des deuxième et troisième années en Guyane et du deuxième cycle aux Antilles-Guyane ?
Nous avons ouvert la deuxième année en 2023 et la troisième en 2024. Ils viennent de terminer. Ils sont dix-neuf. Ils vont continuer aux Antilles-Guyane. Certains de leurs enseignants sont des Antilles, tout comme nous enseignons aux étudiants des Antilles. Les étudiants de deuxième cycle – ce qu’on appelle l’externat – ont une carte d’étudiant des Antilles avec la possibilité d’effectuer leurs stages hospitaliers en Guyane. En deuxième cycle, ils passent la moitié du temps en cours et la moitié en stage. Cela leur donne la possibilité de découvrir les services. Dès 2023, nous avons eu une étudiante qui a effectué toute sa quatrième année en Guyane. Donc dès maintenant, nous pouvons envisager qu’un étudiant qui veut devenir généraliste effectue l’intégralité de son cursus en Guyane.
Il y a régulièrement des interrogations sur le niveau des étudiants de première année en Guyane. Quel est votre constat ?
Il y a quinze ans, les meilleurs lycéens s’inscrivaient en Métropole. De plus en plus, ils s’inscrivent ici. Cela va jouer. Ensuite, grâce à la création des deuxième et troisième années, nous avons pu mettre en place un tutorat très actif. Des étudiants de deuxième année, en majorité, animent des sessions pour ceux de première année. Cela leur donne un rythme de travail, tout comme les examens blancs.
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

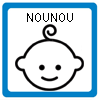
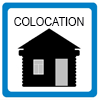

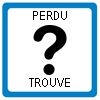


associations, postez vos actualités
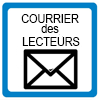
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5