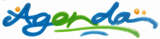Blada.com
jeudi 22 janvier
Boîtes aux lettres
Courrier des lecteurs
Petites annonces
Emploi / Formation
Covoiturage
Infos citoyennes
Infos citoyennes
03/10/25
Du concret pour la santé environnement
Mardi 30 septembre, l’ARS, la CTG et la préfecture ont signé le Plan régional santé environnement. Le document se concentre sur vingt-six actions, dont certaines ont déjà débuté. Leur mise en œuvre est prévue d’ici à 2028.

Mesurer la qualité de l’air dans quatre écoles du territoire, élaborer une charte de qualité sur le marché de Cayenne, mettre en œuvre le plan contre la leptospirose, accompagner les mairies dans le respect des nouvelles obligations d’accès à l’eau potable, sensibiliser les élus sur leur compétence déchets... Voici quelques-unes des actions incluses dans le Plan régional santé environnement (PRSE). Le document a été signé mardi matin par l’Agence régionale de santé, la Collectivité territoriale et la préfecture, en présence du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane (Ceseceg), qui a présidé les travaux préparatoires.
Le document, établi pour la période 2024-2028, « a été concentré sur vingt-six actions qui ont toutes des chances d’aboutir, qui répondent à des besoins concrets de la population, qui sont portées par des acteurs de terrain- et qui pour beaucoup ont des financements déjà identifiés », souligne Marion Tissier, embauchée par Guyane promotion santé (GPS) pour piloter la mise en œuvre du PRSE. Laurent Bien, directeur général de l’ARS, insiste sur sa « particulière vigilance pour la traduction concrète de ces actions ».
Ces actions sont articulées autour de cinq axes :
- Vivre dans un environnement favorable à la santé ;
- Réduire les inégalités territoriales ;
- Limiter l’impact des maladies zoonotiques et la diffusion des maladies infectieuses émergentes ;
- Développer une culture partagée en santé environnement ;
- Améliorer la qualité des ressources alimentaires des Guyanais.
Pour les choisir, un travail de concertation a été initié en 2023 : concertation en ligne de la population, focus group avec les habitants de Cogneau-Lamirande et Balata, séances du Groupe régional santé environnement (GRSE) réunissant de nombreux acteurs de ce sujet. Deux principaux sujets avaient émergé : les dépôts sauvages de déchets et l’alimentation en eau potable. Plusieurs actions seront en rapport. Pour Ariane Fleurival, présidente du Ceseseg, c’est la preuve que « la santé environnementale est désormais une affaire collective au cœur de nos politiques publiques. »
« On s’étonne d’avoir des enfants avec des problèmes respiratoires »
 Grâce à des financements de l’ARS et de la CTG, Atmo Guyane effectuera des mesures de la qualité de l’air dans quatre établissements scolaires secondaires du territoire, dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE) : une par intercommunalité. Dans le même temps, l’association mènera des études pour déterminer l’origine d’éventuelles pollutions.
Grâce à des financements de l’ARS et de la CTG, Atmo Guyane effectuera des mesures de la qualité de l’air dans quatre établissements scolaires secondaires du territoire, dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE) : une par intercommunalité. Dans le même temps, l’association mènera des études pour déterminer l’origine d’éventuelles pollutions.
Rodolphe Sorps, son président, justifie cette étude : « On nous dit toujours qu’en Guyane, nous vivons à l’air libre. Mais non, nous vivons dans la climatisation. Voilà ce qu’on fait vivre à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. » Joseph Rwagitinywa, directeur de la démoustication et des actions sanitaires à la CTG, poursuit : « Les enfants passent huit heures par jour dans des environnements clos comme les salles de classe avec, à l’extérieur, des parkings sur lesquels les parents stationnent en laissant le moteur de la voiture allumé. On ajoute les poussières du Sahara. Après, on s’étonne d’avoir des enfants avec des problèmes respiratoires sur le territoire. C’est un enjeu majeur pour la Guyane. »
C’est la première fois que ce type d’étude sera mené sur le territoire. Outre les polluants, elle prévoit de rechercher les champignons et les bactéries présents. « C’est un modèle d’étude que nous pourrons ensuite reproduire dans d’autres écoles de Guyane. »
A Saint-Laurent, cocona, patates en l’air et pereskia attendent d’être mangés

Au lycée agricole Cécile-Chauviet de Saint-Laurent-du-Maroni, après avoir contourné les bungalows des salles de classe et tourner devant les innombrables bananiers, le visiteur passe sous une serre d’un genre particulier. Gérée par l’Association des producteurs de l’Ouest guyanais (Apogu), elle abrite des dizaines de plantes différentes : corète potagère, basilic africain, cocona, patates en l’air, pereskia… Toutes ces variétés sont ce qu’on appelle des plantes alimentaires non conventionnelles : des plantes comestibles, poussant à l’état naturelle – et donc parfaitement adaptée au climat – mais rarement produites par les agriculteurs. Le PRSE vise à construire une filière de valorisation de ces plantes.
« Si on prend le cocona, par exemple, c’est notre substitut à la tomate, explique Sébastien Léo, président de l’Apogu. Ça pousse sans difficulté. C’est très résistant aux maladies. Il m’arrive même de greffer des plants de tomates dessus. Avec le fruit, on peut faire des jus, des sauces. Ceux qui le connaissent bien prépare le poisson avec, comme une pimentade. »
Plus loin, l’agriculteur se penche pour montrer une variété de patate douce « très résistante contre le charançon ». Un organisme de recherche lui a demandé d’en planter sur son exploitation, pour étudier son évolution. Sébastien Léo prend arrache ensuite une feuille. « C’est une salade qui pousse très facilement. Il y en a plein en ville, mais les gens ne savent pas ce que c’est et que ça se consomme. »
Toutes ces plantes alimentaires, les producteurs de l’Ouest ont d’ores déjà la possibilité de venir en récupérer gratuitement, dans la serre du lycée agricole. L’objectif est « d’amplifier le nombre d’espèces végétales comestibles sur les parcelles agricoles, en les faisant cohabiter avec les cultures traditionnelles. Cela doit permettre à l’agriculteur d’avoir un panel de production dont les récoltes s’étalent dans le temps et donc d’avoir des revenus tout au long de l’année à partir d’un investissement très faible. »
Grâce au PRSE, l’Apogu va faire réaliser des études techniques et financières sur ces plantes. Elle va également construire une seconde serre, pour des projets sociaux : la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni envisage d’installer des plantes dans des quartiers et des écoles de la ville. En 2014, la CTG et la Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (Daaf) avaient financé l’ouvrage Les Plantes alimentaires non conventionnelles, afin de les faire connaître ainsi que la manière de les consommer. A l’avenir, l’Apogu projette de construire une « Maison de l’alimentation » qui comprendrait un espace de coworking, un atelier de transformation, une cuisine pédagogique, un magasin d’usine… « C’est l’intérêt de ce travail, souligne Habib Adebo, technicien agricole pour l’Apogu : il y a le travail des agriculteurs, mais également tout le travail de sensibilisation du public. »
L’Anses ouvre la porte à la bactérie Wolbachia
 Empêcher le développement des œufs d’Aedes aegypti : tel est l’intérêt de la bactérie Wolbachia. Depuis plusieurs années, l’Institut Pasteur de Guyane travaille sur cette technique. En novembre 2024, Emmanuelle Clervil, doctorante, avait soutenu sa thèse sur le sujet (lire la Lettre pro du 5 novembre 2024). L’Agence national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) présente la technique ainsi, dans un avis du 18 septembre : « Des mâles porteurs d’une souche particulière de la bactérie Wolbachia sont lâchés. Cette bactérie est naturellement présente chez de nombreux insectes et se transmet des femelles à leur descendance. Si une femelle porteuse d’une souche différente, ou non porteuse de la bactérie, s’accouple avec un mâle porteur de la souche sélectionnée, alors les œufs ne se développent pas. » Le PRSE, signé le 30 septembre, prévoit la poursuite des études sur le sujet.
Empêcher le développement des œufs d’Aedes aegypti : tel est l’intérêt de la bactérie Wolbachia. Depuis plusieurs années, l’Institut Pasteur de Guyane travaille sur cette technique. En novembre 2024, Emmanuelle Clervil, doctorante, avait soutenu sa thèse sur le sujet (lire la Lettre pro du 5 novembre 2024). L’Agence national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) présente la technique ainsi, dans un avis du 18 septembre : « Des mâles porteurs d’une souche particulière de la bactérie Wolbachia sont lâchés. Cette bactérie est naturellement présente chez de nombreux insectes et se transmet des femelles à leur descendance. Si une femelle porteuse d’une souche différente, ou non porteuse de la bactérie, s’accouple avec un mâle porteur de la souche sélectionnée, alors les œufs ne se développent pas. » Le PRSE, signé le 30 septembre, prévoit la poursuite des études sur le sujet.
La technique Wolbachia fournit une alternative à la lutte chimique, qui fait face à une plus grande résistance des moustiques. Pour Jean-Bernard Duchemin, responsable de l’unité d’entomologie médicale à l’Institut Pasteur de Guyane, « des arguments scientifiques montrent l’efficacité des Wolbachia en introgression (remplacement de population) dans le vecteur Aedes aegypti pour limiter l’incidence des cas de dengue, et à moindre degré pour le virus chikungunya. En juin, avec ArboFrance, nous avons étudié tout ce qui avait été fait sur ce sujet. Nous sommes arrivés exactement aux mêmes conclusions que l’Anses. »
La technique est en effet déjà utilisée depuis le début des années 2010 en Australie, et depuis quatre ans en Nouvelle-Calédonie. « Sur ce territoire, il n’y a pas eu d’épidémie de dengue en 2024, alors qu’il y en avait partout dans le monde », constate le chercheur. Ce remplacement de la population d’Aedes grâce à la bactérie Wolbachia présente également un avantage économique, souligne-t-il : contrairement aux lâchers de mâles stériles, une fois « c’est du one shot. Il n’y a pas besoin de recommencer. »
Cet avis de l’Anses ouvre la porte à la possibilité de mettre en place cette technique en Guyane. L’Institut Pasteur poursuit ses recherches dessus. L’Anses invite à étudier les effets non intentionnels et à travailler sur l’acceptabilité sociale de la technique. Pour son travail de thèse, Emmanuelle Clervil était intervenue auprès de lycéens, qui n’avaient pas exprimé d’opposition. Enfin, l’Agence rappelle l’importance des mesures de prévention contre la prolifération des moustiques, à commencer par la lutte contre les gîtes larvaires.
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

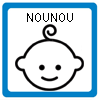
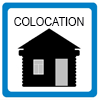

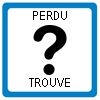


associations, postez vos actualités
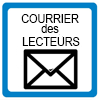
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5