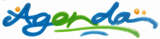Blada.com
Il est 22:05 en Guyane
dimanche 21 décembre
dimanche 21 décembre
le marron - chroniques atypiques de la guyane française
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)
 Droits des peuples autochtones
Droits des peuples autochtoneset création d’aires protégées :
Le cas du Parc national de la Guyane
Par Alexis Tiouka
Spécialiste en droit international
et en droits des peuples autochtones
La Guyane constitue l’unique département français localisé sur le continent sud-américain. Au Sud de ce territoire, couvert à plus de 95% de forêt tropicale humide, vivent des peuples autochtones dont le rapport à l’environnement naturel constitue le fondement de leur société. Or, cet environnement est actuellement menacé, notamment par des exploitations minières tant légales qu’illégales. L’objectif du parc national est à ce titre de préserver cet environnement tout en accompagnant des sociétés qui sont à un tournant de leur histoire. Cependant, malgré cet objectif louable, sa création fait débat et pose un certain nombre de problèmes qui sont intrinsèquement liés à la question des aires protégées au regard des droits des peuples autochtones.
Aires protégées et peuples autochtones
Dans l’histoire des droits des peuples autochtones, la création des aires protégées a toujours fait débat dans la mesure où elles ont le plus souvent conduit à des déplacements de peuples autochtones ainsi qu’à la spoliation de leurs ressources naturelles. On trouve néanmoins chez les peuples autochtones du monde des réactions diversifiées face à cette question : certains d’entre eux acceptent et reconnaissent la validité de la création d’aires protégées tandis que d’autres refusent ce qu’ils perçoivent comme une imposition extérieure allant à l’encontre de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles.
Par ailleurs, à cette lutte contre la création d’aires protégées s’ajoutait l’opposition à certains mouvements écologistes qui considéraient celles-ci comme des zones où ne devaient subsister que la faune et la flore et donc où devait être proscrite toute présence humaine. Une telle attitude avait bien évidemment eu pour conséquence de nombreux conflits entre peuples autochtones, écologistes et responsables des aires protégées.
Enfin, le dernier point qui posait problème dans la création de telles zones était l’absence de prise en compte de l’avis des peuples autochtones.
Ce n’est que vers les années 90 que l’on peut constater une évolution dans ce domaine, et ce à différents niveaux. C’est en effet à cette époque que les peuples autochtones ont commencé à demander qu’avant toute mise en place d’une aire protégée soit reconnus leurs droits territoriaux et que soit pris en compte leur consentement libre et informé. Il n’était pas question pour eux de mettre au second plan la protection de la biodiversité, mais bien de permettre que celle-ci s’inscrive dans un respect des droits de l’homme et des droits des peuples autochtones.
Les revendications autochtones commenceront à être réellement prises en compte assez rapidement dans cette décennie. Et plus particulièrement au travers de deux événements : le Ve congrès des Parcs de Caracas (1992) et le congrès mondial de la nature de Montréal (1996). Lors du premier de ces deux congrès, un appel sera fait pour le développement d’une politique sur les aires protégées dans le but de défendre avec efficacité les intérêts des peuples autochtones. Le Ve congrès va d’ailleurs consolider cette demande en déclarant que la question autochtone est transversale à toute discussion concernant les aires protégées. Quant au congrès de Montréal, quatre ans plus tard, il conduira à l’adoption d’une directive concernant les peuples autochtones et les aires protégées. Celle-ci incite les responsables de ces aires « à mettre en place une politique claire concernant les aires protégées établies sur les terres et territoires des peuples autochtones ».
C’est ainsi que, progressivement, au niveau international, se dégagent les principes de base de la mise en place des aires protégées dans le respect des droits des peuples autochtones.
Les principes qui apparaissent de manière récurrente, tant dans les revendications autochtones qu’au niveau des textes internationaux, se déclinent généralement comme suit :
Aires protégées et peuples autochtones
Dans l’histoire des droits des peuples autochtones, la création des aires protégées a toujours fait débat dans la mesure où elles ont le plus souvent conduit à des déplacements de peuples autochtones ainsi qu’à la spoliation de leurs ressources naturelles. On trouve néanmoins chez les peuples autochtones du monde des réactions diversifiées face à cette question : certains d’entre eux acceptent et reconnaissent la validité de la création d’aires protégées tandis que d’autres refusent ce qu’ils perçoivent comme une imposition extérieure allant à l’encontre de leurs droits à la terre et aux ressources naturelles.
Par ailleurs, à cette lutte contre la création d’aires protégées s’ajoutait l’opposition à certains mouvements écologistes qui considéraient celles-ci comme des zones où ne devaient subsister que la faune et la flore et donc où devait être proscrite toute présence humaine. Une telle attitude avait bien évidemment eu pour conséquence de nombreux conflits entre peuples autochtones, écologistes et responsables des aires protégées.
Enfin, le dernier point qui posait problème dans la création de telles zones était l’absence de prise en compte de l’avis des peuples autochtones.
Ce n’est que vers les années 90 que l’on peut constater une évolution dans ce domaine, et ce à différents niveaux. C’est en effet à cette époque que les peuples autochtones ont commencé à demander qu’avant toute mise en place d’une aire protégée soit reconnus leurs droits territoriaux et que soit pris en compte leur consentement libre et informé. Il n’était pas question pour eux de mettre au second plan la protection de la biodiversité, mais bien de permettre que celle-ci s’inscrive dans un respect des droits de l’homme et des droits des peuples autochtones.
Les revendications autochtones commenceront à être réellement prises en compte assez rapidement dans cette décennie. Et plus particulièrement au travers de deux événements : le Ve congrès des Parcs de Caracas (1992) et le congrès mondial de la nature de Montréal (1996). Lors du premier de ces deux congrès, un appel sera fait pour le développement d’une politique sur les aires protégées dans le but de défendre avec efficacité les intérêts des peuples autochtones. Le Ve congrès va d’ailleurs consolider cette demande en déclarant que la question autochtone est transversale à toute discussion concernant les aires protégées. Quant au congrès de Montréal, quatre ans plus tard, il conduira à l’adoption d’une directive concernant les peuples autochtones et les aires protégées. Celle-ci incite les responsables de ces aires « à mettre en place une politique claire concernant les aires protégées établies sur les terres et territoires des peuples autochtones ».
C’est ainsi que, progressivement, au niveau international, se dégagent les principes de base de la mise en place des aires protégées dans le respect des droits des peuples autochtones.
Les principes qui apparaissent de manière récurrente, tant dans les revendications autochtones qu’au niveau des textes internationaux, se déclinent généralement comme suit :
- Toutes les aires protégées existantes ou futures doivent être gérées par et établies avec le plein respect des droits des peuples autochtones et des peuples nomades.
- Les comités de gestion des aires protégées doivent contenir des représentants élus par les peuples autochtones.
A cette évolution, s’ajoute le fait que peu à peu les institutions internationales vont tendre à reconnaître les compétences autochtones en matière de gestion de la biodiversité. Aux principes énoncés ci-dessus, s’ajoutera donc l’idée fondamentale selon laquelle les systèmes autochtones garantissent la conservation de la biodiversité. Cette idée s’appuie sur l’exemple de certains pays (comme l’Inde, la Colombie ou la Bolivie) où des aires protégées gérées par des peuples autochtones – non reconnues officiellement – sont en bien meilleur état que celles qui ont été créées par les gouvernements. De ceci découle un troisième principe : on doit reconnaître la manière ancestrale traditionnelle et collective de gérer les terres et territoires autochtones.
Divers instruments internationaux vont venir appuyer ces premières avancées. Elles contribueront chacune à leur manière à faire des principes énoncés ci-dessus des principes incontournables pour toute mise en place d’une aire protégée. La première d’entre elles est la Déclaration de Rio, qui dans son « principe numéro 15 » reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés. De cette déclaration naîtra la Convention sur la biodiversité qui reconnaît dans son préambule le rôle des peuples autochtones qui entretiennent des modes de vie traditionnels en adéquation avec la protection de l’environnement et son utilisation durable. Elle reconnaît en outre qu’un partage équitable des bénéfices qui découlent de l’utilisation de leurs ressources naturelles est nécessaire. La Convention relative aux zones humides de Ramsar (Iran) va quant à elle insister sur l’idée selon laquelle il faut assurer l’utilisation équilibrée des ressources naturelles des zones humides dans la mesure où il s’agit là de zones essentielles à la survie des peuples autochtones qui y vivent. Enfin, la Convention rédigée dans le cadre de la Conférence des Parties de Kuala Lumpur insiste sur le fait que les peuples autochtones doivent participer à la gestion des aires protégées. L’objectif 2.1. de cette Convention précise en effet qu’il faut avant l’année 2008 établir des programmes qui favorisent une distribution équitable des bénéfices issus des aires protégées afin que les peuples autochtones puissent en bénéficier.
A l’heure actuelle, ces différents principes qui fondent toute discussion au niveau international sur la question des aires protégées ont été validés par les Nations Unies et inclus dans la Recommandation de Durban du Ve Congrès des Parcs (8-17 septembre 2003). Ils doivent donc être à la base de toute mise en place d’une aire protégée et c’est au regard de ceux-ci que doit être pensée la création du Parc National de la Guyane.
La création du Parc national de la Guyane
La création d’un tel outil ne peut donc faire l’impasse du respect des principes suivants :
Divers instruments internationaux vont venir appuyer ces premières avancées. Elles contribueront chacune à leur manière à faire des principes énoncés ci-dessus des principes incontournables pour toute mise en place d’une aire protégée. La première d’entre elles est la Déclaration de Rio, qui dans son « principe numéro 15 » reconnaît que « la meilleure manière de traiter les questions environnementales est de permettre la participation des peuples autochtones concernés. De cette déclaration naîtra la Convention sur la biodiversité qui reconnaît dans son préambule le rôle des peuples autochtones qui entretiennent des modes de vie traditionnels en adéquation avec la protection de l’environnement et son utilisation durable. Elle reconnaît en outre qu’un partage équitable des bénéfices qui découlent de l’utilisation de leurs ressources naturelles est nécessaire. La Convention relative aux zones humides de Ramsar (Iran) va quant à elle insister sur l’idée selon laquelle il faut assurer l’utilisation équilibrée des ressources naturelles des zones humides dans la mesure où il s’agit là de zones essentielles à la survie des peuples autochtones qui y vivent. Enfin, la Convention rédigée dans le cadre de la Conférence des Parties de Kuala Lumpur insiste sur le fait que les peuples autochtones doivent participer à la gestion des aires protégées. L’objectif 2.1. de cette Convention précise en effet qu’il faut avant l’année 2008 établir des programmes qui favorisent une distribution équitable des bénéfices issus des aires protégées afin que les peuples autochtones puissent en bénéficier.
A l’heure actuelle, ces différents principes qui fondent toute discussion au niveau international sur la question des aires protégées ont été validés par les Nations Unies et inclus dans la Recommandation de Durban du Ve Congrès des Parcs (8-17 septembre 2003). Ils doivent donc être à la base de toute mise en place d’une aire protégée et c’est au regard de ceux-ci que doit être pensée la création du Parc National de la Guyane.
La création du Parc national de la Guyane
La création d’un tel outil ne peut donc faire l’impasse du respect des principes suivants :
- reconnaissance du droit des communautés à participer à la gestion et à l’administration de leurs ressources naturelles et de leurs territoires;
- distribution juste et équitable des bénéfices tirés de l’exploitation des ressources se situant sur les aires protégées;
- mise en place de cadres permettant de prévenir et de gérer les conflits qui dérivent de l’utilisation des ressources naturelles des autochtones;
- reconnaissance de la nécessité que les peuples autochtones soient propriétaires de manière coutumière ou légale des terres et territoires sur lesquels se trouvent les aires protégées.
Or c’est bien sur ces différents points que, depuis le début de la mise en place du Parc national de la Guyane, peuples autochtones et acteurs de l’Etat se sont confrontés et ont débattu.
L’histoire de la création du Parc de la Guyane débute en 1970, date à laquelle des spécialistes des sciences de la nature proposent la création d’une aire protégée dans le sud du département. Mais il faut attendre le Sommet de Rio, en 1992, pour que le Conseil régional et le Conseil général de la Guyane ainsi que l’Etat signent un protocole d’accord où ils s’engagent à créer dans ce département une aire forestière protégée.
Suite à cet engagement une mission d’étude sera mise en place dès 1993, son travail aboutira, en 1995, à une première proposition. Celle-ci présente une zone protégée où les activités humaines sont interdites, une zone périphérique qui englobe les villages des peuples autochtones mais aussi des zones d’activité minière contrôlée. Cette première proposition est refusée d’emblée, et notamment par les peuples autochtones qui revendiquent, au nom du droit à un consentement libre et informé, ainsi que du droit à la participation à la mise en place de ce type d’outil, d’être plus associés à l’élaboration du Parc. Par ailleurs, ces peuples refusent d’être « parqués » dans les zones concernées.
Deux ans plus tard, en 1997, on inclut finalement les peuples autochtones dans les négociations. De celles-ci vont découler un nouvel accord qui accorde un certain nombre de droits aux peuples autochtones vivant traditionnellement sur ces territoires :
L’histoire de la création du Parc de la Guyane débute en 1970, date à laquelle des spécialistes des sciences de la nature proposent la création d’une aire protégée dans le sud du département. Mais il faut attendre le Sommet de Rio, en 1992, pour que le Conseil régional et le Conseil général de la Guyane ainsi que l’Etat signent un protocole d’accord où ils s’engagent à créer dans ce département une aire forestière protégée.
Suite à cet engagement une mission d’étude sera mise en place dès 1993, son travail aboutira, en 1995, à une première proposition. Celle-ci présente une zone protégée où les activités humaines sont interdites, une zone périphérique qui englobe les villages des peuples autochtones mais aussi des zones d’activité minière contrôlée. Cette première proposition est refusée d’emblée, et notamment par les peuples autochtones qui revendiquent, au nom du droit à un consentement libre et informé, ainsi que du droit à la participation à la mise en place de ce type d’outil, d’être plus associés à l’élaboration du Parc. Par ailleurs, ces peuples refusent d’être « parqués » dans les zones concernées.
Deux ans plus tard, en 1997, on inclut finalement les peuples autochtones dans les négociations. De celles-ci vont découler un nouvel accord qui accorde un certain nombre de droits aux peuples autochtones vivant traditionnellement sur ces territoires :
- le droit d’y pratiquer leurs activités traditionnelles ;
- le droit d’y circuler librement.
Les peuples autochtones ainsi que les représentants écologistes obtiennent de plus que soient interdites sur ces zones toute activité minière. Le projet est refusé en 1999, mais cette fois essentiellement du fait de l’implication des lobby miniers qui s’insurgent contre le fait que les activités minières soient interdites sur des zones biologiquement riche mais qui possèdent par ailleurs un fort potentiel aurifère.
Le projet est ensuite interrompu, essentiellement du fait de changements politiques et institutionnels qui touchent le département guyanais. Cependant, le débat est relancé en 2003, suite au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002. Il l’est avec une prise en compte effective, cette fois, de la spécificité des départements d’Outre-Mer.
La création d’un tel Parc revêt des enjeux politiques à la fois au niveau national et au niveau international. En effet, depuis le Sommet de Rio de 1992, les Etats du monde entier ont semble-t-il pris conscience de l’importance des ressources des forêts tropicales en terme de biodiversité ainsi que de l’accroissement de la pression humaine qui réduit leurs surfaces. Or, les forêts tropicales, en plus de receler plus de la moitié des espèces vivantes de la planète, jouent un rôle essentiel dans les grands équilibres planétaires. De plus, les sommets de Rio et de Johannesburg, ainsi que le Ve Congrès mondial des Parcs nationaux de Durban, ont mis en évidence la nécessité de replacer l’homme au centre des préoccupations environnementales, et plus particulièrement de faire participer les populations à toutes les phases de son élaboration.
Or, diverses populations sont concernées par la création du Parc national et, parmi elles, les peuples autochtones du département. Cette présence est de fait prise en compte dans la création du Parc national sous différentes formes :
Le projet est ensuite interrompu, essentiellement du fait de changements politiques et institutionnels qui touchent le département guyanais. Cependant, le débat est relancé en 2003, suite au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002. Il l’est avec une prise en compte effective, cette fois, de la spécificité des départements d’Outre-Mer.
La création d’un tel Parc revêt des enjeux politiques à la fois au niveau national et au niveau international. En effet, depuis le Sommet de Rio de 1992, les Etats du monde entier ont semble-t-il pris conscience de l’importance des ressources des forêts tropicales en terme de biodiversité ainsi que de l’accroissement de la pression humaine qui réduit leurs surfaces. Or, les forêts tropicales, en plus de receler plus de la moitié des espèces vivantes de la planète, jouent un rôle essentiel dans les grands équilibres planétaires. De plus, les sommets de Rio et de Johannesburg, ainsi que le Ve Congrès mondial des Parcs nationaux de Durban, ont mis en évidence la nécessité de replacer l’homme au centre des préoccupations environnementales, et plus particulièrement de faire participer les populations à toutes les phases de son élaboration.
Or, diverses populations sont concernées par la création du Parc national et, parmi elles, les peuples autochtones du département. Cette présence est de fait prise en compte dans la création du Parc national sous différentes formes :
- l’association des autorités coutumières à la gestion du territoire, il est donc prévu que celles-ci soient représentées au conseil d’administration du futur établissement aux côtés des élus et de tous les partenaires ;
- l’assurance du bien-être des peuples autochtones et la prise en compte de leur spécificité culturelle mais en visant aussi une bonne intégration sociale ainsi que l’amélioration de leurs conditions sanitaires. Pour ce faire, le projet du parc prévoit d’impliquer les peuples autochtones dans la définition des types d’équipements adaptés à l’enclavement géographique et à leurs modes de vie ;
- le maintien et la valorisation des cultures matérielles et immatérielles. Le projet tient compte du fait que les peuples autochtones souhaitent conserver leurs activités traditionnelles de subsistance ainsi que leurs pratiques culturelles tout en ayant accès aux biens de consommation et aux services offerts par la société moderne ;
- la pérennisation des pratiques de subsistance. Le projet prévoit de prendre en considération l’interdépendance entre la préservation des milieux et la pérennité des pratiques des peuples autochtones avec les savoirs et les techniques propres à chaque communauté ;
- la possibilité de mettre en place des activités économiques durables. Le parc national vise entre autres à favoriser le développement de certaines activités économiques telles que le tourisme, l’artisanat et l’agriculture mais toujours en y associant étroitement les peuples autochtones ;
- et enfin, l’éradication des activités minières ayant lieu en amont et à proximité des zones de vie des peuples autochtones. Celles-ci sont en effet source d’une pollution par le mercure ainsi que de désordres sociaux (prostitution, alcoolisme, violence).
Ce projet présente donc l’intérêt de ne pas se contenter de protéger le milieu, il s’inscrit dans un projet de société qui tient compte des particularismes locaux. Enfin, conformément aux textes internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones, il inclut ceux-ci en leur proposant une participation consultative, décisionnelle ainsi qu’une implication directe dans la gestion du Parc.
Alexis Tiouka
indigenous-peoples.gf@wanadoo.frAlexis Tiouka
Février 2006
Réagir à cette chronique
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

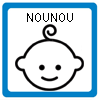


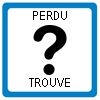


associations, postez vos actualités

participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5