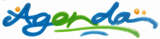Blada.com
mercredi 04 février
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)
Le Pas à pas de l’humanité
par Sylviane Vayaboury
Sylviane Vayaboury est auteure des romans "Rue Lallouette prolongée", L'harmattan juin 2006, et "La Crique", janvier 2010 chez le même éditeur. Cet article a déjà été publié par L'Humanité, en juin 2009
Comment la mémoire de l’esclavage transforme-t-elle l’identité ?
Enfance et esclavage
L’enfance est source d’interrogations multiples. La mienne n’a pas dérogé à la règle. Elle a d’ailleurs été particulièrement boulimique de ces questions qui dérangent, qui mettent mal à l’aise, qui vous invitent à un douloureux voyage.
Je me souviens de notre arrivée à Cayenne, en 1966, de retour de Fort-de-France avec mes grands-parents, et de mon premier passage sur la place Victor-Schoelcher, à Cayenne.
J’ai six ans. Mon entrée balbutiante dans la lecture ne me permet pas de lire sur le socle de l’ensemble statuaire :
« À Victor Schoelcher, la Guyane reconnaissante. La République n’entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle n’exclut personne de son immortelle devise : liberté, égalité, fraternité. »
Je serre alors ma main dans celle de ma grand-mère et lui demande :
« C’est qui le monsieur qui a le bras levé ?
- C’est Victor Schoelcher, tu vois, il montre à l’esclave le chemin de la liberté. C’est pour dire que l’esclavage est fini à ce moment-là.
- Et pourquoi il est mal habillé et on voit ses chaînes cassées ?
- Il devait travailler, mais c’est fini tout ça, et maintenant on est libres. »
Et j’ai continué à bombarder de questions ma bonne-maman de longue lignée d’occultation, celle qui tenait verrouillées les portes d’une mémoire collective, dans la mouvance d’une société créole entraînée sur le parcours de l’oubli et de l’assimilation triomphante.
Et parce que je sentais bien que je finirais par la heurter avec toutes mes questions et qu’elle n’avait pas envie de remuer des histoires vieilles, si vieilles, j’ai gardé enfoui dans ma mémoire des lambeaux d’histoires d’arrière-grands-papas et d’arrière-grands-mammans venus du Congo pour travailler la terre sans la moindre bribe de pénibilité dans l’horreur des chaînes.
Alors, il m’a semblé, pendant longtemps, que notre histoire commençait à partir de ce moment-là, de ce geste libérateur insufflé à l’esclave libéré, et que l’obscurantisme posé sur un « tan lontan » devait trouver ses fondements dans les entrailles d’ancêtres misérabilistes venus de pays lointains et pour lesquels il n’y avait plus lieu d’entretenir une quelconque mémoire.
Puisque Schoelcher avait montré la voie, le chemin balisé nous emmenait tout droit à la francisation et à l’amour indéfectible à la mère patrie libératrice et réparatrice.
Mon éveil au réel s’est forgé dans le choc des découvertes glanées, au fil du temps, dans les ouvrages historiques du Dr Henry, de Serge Mam Lam Fouck et des journaux d’archives.
Cette expérience commune est celle de milliers d’entre nous des « quatre vieilles colonies », dès lors que nous avions pu faire le triste constat de l’absence de l’histoire coloniale dans les manuels scolaires.
Reconnaissante ! Reconnaissante ! N’avaient-ils que ce mot en bouche ? Ce mot étalé, validé dans notre espace urbain ! Sur le socle du monument Schoelcher, sur le socle du calvaire, rue Lallouette, devant la cathédrale Saint-Sauveur, érigé par l’église catholique : « 1948, centenaire de l’émancipation. La Guyane reconnaissante. »
Longtemps porté par des hommes politiques, idolâtres, manipulateurs du fait esclavagiste !
Qu’ils se réveillent les Gustave Franconie, Henri Ursleur et Gaston Monnerville d’une histoire irrecevable en l’état !
Car le temps a oeuvré en faveur du réveil culturel et politique, et les courants nationalistes, si éclatés furent-ils, du MO. GUY. DE, en 1974 (Mouvement guyanais de décolonisation) - je revois Raymond Charlotte à notre fenêtre - au FNLG en 1975 (Fo Nou Libéré la Guyane), en reprenant les grandes lignes des Éveilleurs de conscience guyanaise - je pense à Justin Catayée et à sa formation politique, le PSG, et aux précurseurs que furent les pères de la négritude - ont entrouvert la voie d’une réflexion sur les identités.
Aujourd’hui, en vertu de nombreux travaux et depuis la récente loi Taubira du 21 mai 2001, reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité, de nouvelles représentations de l’esclavage se sont progressivement affirmées, même si une discrétion et une pudeur sont encore très palpables sur les lieux de la tragédie, conjuguant son passé et son présent.
L’enfant qui sommeille en moi se réjouit de ce combat contre l’oubli, de cette reconstruction en marche. Chaque commémoration (du 10 juin pour la Guyane) me renvoie à ce souvenir inaltérable et à l’idéologie de la réparation.
La question de la réparation
Au regard de monuments érigés, de noms de rues attribués par la municipalité rappelant à la mémoire des gestionnaires du système esclavagiste (Jubelin, Laussat) et des abolitionnistes (François Arago, Louis Blanc), on mesure le poids d’une certaine idéologie de la réparation jusque-là entretenue.
Tout ça pour ça ! Pour oublier ou ne pas oublier ? Devoir de reconnaissance et de gratitude !
Depuis la loi Taubira, le terme de « réparation » est devenu le cheval de bataille de bon nombre de groupes engagés dans un même combat de reconnaissance de peuples opprimés.
Dans son livre intitulé Nègre je suis, nègre je resterai, Aimé Césaire confiait, en 2004, à Françoise Vergès : « La réparation, c’est une affaire d’interprétation… Le terme de réparation ne me plaît pas beaucoup… Pour moi, c’est irréparable. »
Césaire nous rappelait que nous avions à penser ce désastre en termes moraux plutôt qu’en termes commerciaux. Ainsi, chaque fois qu’un geste est accompli, que le nom d’un des nôtres est attribué à une place, à une rue, qu’est érigée une statue, que sont enseignées des langues et des cultures régionales, l’histoire des traites négrières et de l’esclavage, que de nouvelles expositions voient le jour (inauguration, ce mois-ci, à Bordeaux, d’une exposition permanente au musée d’Aquitaine consacrée au commerce atlantique et à l’esclavage), nous devrions être tous transportés de joie.
Dans cette histoire d’amour et de haine, chaque pierre posée à l’édifice concourt à revisiter cette histoire douloureuse de manière assumée et dépassionnée : un geste, un pas à chaque fois pour l’humanité tout entière.
De l’occultation à la revendication, de la revendication à la réparation, un travail sur nous-mêmes s’impose désormais pour sortir, à terme, de la victimisation : une tâche complexe, compte tenu de traits ancrés, du poids de l’histoire et de notre relation au monde.
Sylviane Vayaboury
En savoir +
Sylviane Vayaboury, sur le site de L'Harmattan
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

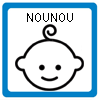
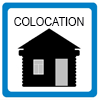

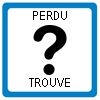


associations, postez vos actualités
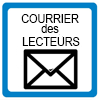
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5